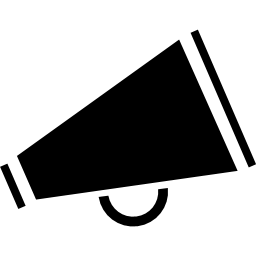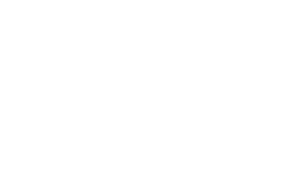Qu’est-ce qu’un centre de soins ?
Un centre de soins de la faune sauvage est un établissement chargé d’accueillir, soigner et rééduquer uniquement des animaux sauvages en détresse afin de les relâcher dans leur milieu naturel.
Il accueille une grande diversité d’animaux : oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens.
Il possède différentes infrastructures (box d’hospitalisation, infirmerie, volières, bassins…) pour accueillir et soigner les animaux et leur permettre de se rétablir avant un relâché.
Un centre de soins est une structure règlementée, autorisée par arrêté préfectoral, dont les activités sont encadrées par le code de l’Environnement.
Un centre de soins faune sauvage ne se visite pas !
En effet, pour garantir le maximum de chances de réintroduction dans leurs milieux naturels et garder leur caractère sauvage, les animaux ne doivent pas être imprégnés par l’Homme.
Il assure également une veille sanitaire (détection d’épizooties, connaissance des maladies, parasites…). Si la rage et la grippe aviaire sont deux risques connus, la faune sauvage est porteuse de nombreux agents pathogènes contagieux. Ainsi, de par le grand nombre d’animaux accueillis, le centre de soins participe à la production de connaissances et de données scientifiques concernant les maladies qui touchent la faune sauvage, la faune domestique et l’Homme. De plus, il mène des actions de sensibilisation et d’éducation à la nature.
Des acteurs-clés
Des équipes dédiées : Les responsables des centres de soins sont titulaires d’un certificat de capacité, délivré par l’État et sont à la tête d’équipes spécialement formées à la prise en charge des espèces sauvages.
Les bénévoles : En Nouvelle-Aquitaine, la quasi-totalité des centres de soins sont portés par des associations. Leur fonctionnement dépend ainsi en grande partie de la mobilisation des membres bénévoles.
Les vétérinaires : Les centres de soins s’appuient fortement sur les vétérinaires (en interne ou en collaboration avec des cabinets vétérinaires), seuls en mesure de procéder à des interventions chirurgicales et habilités à prescrire des médicaments.
Les partenaires : Les collectivités (Région, Départements, parfois communes…) versent ou octroient des aides régulières ou ponctuelles (subventions, mis à disposition gratuite de terrains et ou de locaux…). Le Centre de sauvegarde du Marais aux oiseaux (île d’Oléron) est même porté par le Département de la Charente-Maritime.
La Région s’est dotée d’un schéma régional des centres de soins de la faune sauvage. Des partenaires privés (entreprises, fondations…) apportent également un soutien aux centres de soins.
Des associations naturalistespartenaires échangent régulièrement avec les centres. Elles orientent parfois les personnes vers les centres lorsque cela est nécessaire.
Les services de l’État : C’est l’État qui délivre les autorisations d’ouverture et les certificats de capacité (Direction Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations). L’Office Français de la Biodiversité (OFB) place les animaux saisis (saisie douanière) dans les centres. Il a également un rôle d’inspection et de suivi administratif des centres et vérifie la régularité des relâchés.
Des chiffres clés
- 9 centres répartis sur la région
- Environ 20 salarié.es
- Des centaines de bénévoles
- Plusieurs milliers de sollicitations téléphoniques (médiation, conseils, accueils)
- Plusieurs milliers d’animaux recueillis chaque année (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens) parmi lesquelles des espèces particulièrement rares et menacées (rapaces, oiseaux marins, loutre, cistude…)
- Un grand nombre d’animaux relâchés sur la région permettant de stabiliser certaines populations d’espèces
Devenir bénévole
Le bénévole en soins :
Il consiste à apporter une aide active, régulière et sur une longue durée. Vous êtes formés sur place auprès des équipes spécialisées du centre de soins. Aucune compétence n’est requise.

Les centres de soins de la faune sauvage ne sont pas des refuges ! Le but premier pour les équipes de soigneurs est de réhabiliter les animaux en vue de retourner dans leur milieu naturel. De nombreux cas sont gravement blessés ou très malades. Ainsi, un grand nombre des animaux recueillis ne survit pas. Il faut en prendre conscience avant de se proposer comme bénévole.
Les animaux accueillis en centre de soins sont voués à retourner à l’état sauvage, aucune imprégnation sur un animal n’est tolérée, il n’est donc pas possible de caresser les animaux, de leur parler ou de les prendre en photo.
Le bénévole transporteur :
Une partie des animaux blessés trouvés sont amenés directement au centre de soins le plus proche. L’autre partie des cas ne peuvent pas être amenés par les découvreurs. C’est pourquoi, le bénévole transporteur achemine les animaux trouvés jusqu’au centre de soins.
Il est nécessaire d’avoir le permis de conduire et un véhicule personnel.
Pas de musique dans les voitures pendant le transport vers le centre de soins.
Vous souhaitez vous investir et agir en tant que bénévole pour aider les animaux sauvages en détresse ? Contactez un centre de soins pour proposer votre aide !
Point légal

- La détention d’un animal sauvage prélevé dans la nature par un particulier est strictement interdite. D’après l’article 415-3 du code de l’environnement, cette infraction est passible de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
- Le transport d’un animal sauvage (vivant ou mort) est interdit. Toutefois, une circulaire du 12 juillet 2004 autorise aux particuliers, qui découvrent un animal en détresse, de le transporter vers le centre de sauvegarde le plus proche et par le chemin le plus court après avoir prévenu le centre de sauvegarde et l’OFB, la gendarmerie ou la police.
- D’après l’article R242-48 du code rural et la circulaire du 12 juillet 2004, tous les vétérinaires ont le droit d’apporter des soins à un animal sauvage en détresse. S’ils décident de ne pas le faire, ils doivent renvoyer cet animal vers un confrère capable de le soigner (ou un centre de soins).
- L’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux centres de sauvegarde de la faune sauvage, précise les conditions de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
- L’arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d’expérience professionnelle requis par l’article R. 413-5 du code de l’environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques
- La circulaire du 12 juillet 2004 est relative au suivi des activités des centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage
La faune sauvage est victime de nombreuses atteintes d’origines diverses : animaux domestiques (chats, chiens), collisions routières, chocs contre des vitres, dégradations des milieux naturels, dénichages lors de travaux de jardinage, électrocutions, conditions climatiques défavorables, pollutions, détentions illégales, destructions par tirs, piégeages, empoisonnements, mazoutages lors de marées noires ou de dégazages clandestins plus discrets…
Les occasions de porter atteinte à la faune sauvage sont malheureusement nombreuses. En offrant une seconde chance à ces animaux, les centres de soins de la faune sauvage jouent un rôle essentiel dans le maintien et la conservation des populations.