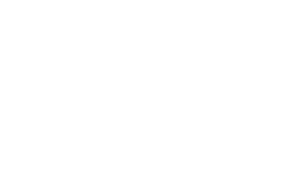Présentation au FIFO des missions et défis des centres de soins en Nouvelle-Aquitaine
 Le samedi 1er novembre, l’ARB NA et la Région Nouvelle-Aquitaine ont présenté le réseau des centres de soins pour la faune sauvage de la région.
Le samedi 1er novembre, l’ARB NA et la Région Nouvelle-Aquitaine ont présenté le réseau des centres de soins pour la faune sauvage de la région.
Cette intervention s’est tenue dans le cadre du 41ème Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute, à l’occasion des Apéros FIFO organisés par EDF.
Lors de cette présentation, Olivier Brousseau, représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine, est revenu sur la création et le fonctionnement de ce réseau régional financé par la Région.
Il regroupe aujourd’hui neuf centres : Hegalaldia, Tonneins, Charente Nature, LPO Aquitaine, L’Arche de Marie, le Centre de Soins de la Faune Sauvage Poitevine, le Marais aux Oiseaux, Paloume et SOS Faune Sauvage.

Le public a ainsi pu découvrir le rôle essentiel de ces structures, à travers le parcours typique d’un animal en détresse pris en charge dans un centre : examen, diagnostic, soins, nourrissage, rééducation (en volière ou en enclos extérieur), jusqu’à son relâcher dans la nature.
Les participants ont également pris conscience des défis quotidiens auxquels ces structures font face.
Les centres de soins sont des établissements agréés par l’État, habilités à accueillir des animaux sauvages blessés, affaiblis, malades ou orphelins, dans le but de les soigner et de les réintroduire dans leur milieu naturel.
Chaque année, les neuf centres de Nouvelle-Aquitaine prennent en charge près de 20 000 animaux, dont environ 50 % sont relâchés.

Les animaux accueillis sont majoritairement des oiseaux, notamment le martinet noir, mais aussi des mammifères tels que le hérisson d’Europe ou l’écureuil roux.
D’autres espèces patrimoniales ou menacées bénéficient également de leurs soins : Loutre d’Europe, Balbuzard pêcheur, Milan royal, Cistude d’Europe, Chevêche d’Athéna, ainsi que quelques reptiles, en moindre proportion.
Derrière chaque admission, il existe une cause souvent liée à l’activité humaine :
- Collisions (véhicules, vitres)
- Attaques d’animaux domestiques (les chats principalement)
- Chutes de nids ou ramassage inutile de jeunes animaux
- Phénomènes climatiques extrêmes (canicules, tempêtes, sécheresses, vagues de froid)
- Pollution, empoisonnement, braconnage, destruction des habitats naturels
Le fonctionnement des centres repose sur un réseau de soigneurs, vétérinaires, bénévoles, stagiaires et services civiques, en lien étroit avec des partenaires tels que les pompiers et l’OFB.

Malgré leur engagement, ces structures doivent faire face à plusieurs défis majeurs :
- Une forte augmentation de l’activité au printemps et en été, accentuée par les effets du changement climatique (ex. : tempêtes affectant les océanites)
- Un manque de financements récurrents
- La nécessité de sensibiliser le public, car de nombreux mauvais gestes persistent (ramasser un faon, nourrir un oiseau avec du pain, etc.)
- La gestion des espèces exotiques envahissantes
En définitive, les centres de soins sont à la fois soignants, éducateurs et lanceurs d’alerte. Soigner un animal sauvage, ce n’est pas seulement sauver un individu : c’est contribuer à la préservation d’un maillon essentiel de nos écosystèmes. En soutenant ces centres, en relayant leurs messages et en adoptant les bons réflexes face à la faune, chacun de nous participe à la préservation du vivant.
Un temps d’échange avec le public a clôturé la présentation, permettant aux intervenants de répondre aux nombreuses questions posées dont la prise en charge de mammifères marins (dauphins), la possibilité de s’engager en tant que bénévoles soins ou transporteurs.